
Frédéric Lenoir : bonheur, mode d’emploi
Le bonheur peut-il être durable, ou sommes-nous condamnés à ne le goûter que par échantillons ? Dépend-il de nous, peut-on le cultiver ? Le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir tente de répondre à ces questions par une réflexion philosophique accessible à tous, qu’il étaye en convoquant les grands sages d’hier et d’aujourd’hui, d’Epicure à Spinoza en passant par Socrate et Montaigne.
En compagnie d’Epictète et de Bouddha on s’avisera que l’on ne peut tendre vers le « bien-être subjectif » cher aux psychologues (traduisez : le bonheur en tant qu’état global) qu’en appréciant les bons moments de l’existence, en ayant conscience de leur qualité et de leur caractère aléatoire, éphémère et précieux. On dévore les 220 pages de l’ouvrage comme un bon roman et on ressort de sa lecture rasséréné quant à notre capacité, mieux comprise que jamais, à savoir voir le bonheur lorsqu’il se présente (et non le fuir de peur qu’il se sauve…) et l’apprivoiser pour en faire un compagnon de route. Frédéric Lenoir a répondu aux questions d’Yves Denis.
Dandy : Alors, ce bonheur : instants ou état ?
Frédéric Lenoir : « Les Grecs l’ont défini comme état global, et cela rejoint exactement ce que diront après eux les Orientaux, Chinois et Bouddhistes : contrairement au plaisir le bonheur est un état global et durable. C’est donc quelque chose qui se construit. On a des moments de joie et de plaisir, à la suite desquels on peut retomber très vite dans la tristesse ou le malheur, alors que le bonheur se construit progressivement. Et c’est là que les choses deviennent compliquées, parce qu’il se construit en sachant savourer et conscientiser tous les petits plaisirs de la vie : si les moments de plaisir sont bien conscientisés, leur succession participe à la création d’un bonheur plus global. C’est pourquoi il n’y a pas d’opposition entre plaisir et bonheur : le plaisir contribue au bonheur mais n’y suffit pas, il faut aussi une conscience, une attention, une vigilance, un travail sur soi, pour changer progressivement son regard intérieur et arriver à être capable de faire durer cet état de bien-être.
D’où la nécessité d’avoir conscience des moments de bonheur, sur laquelle vous insistez…
FL : Tout ce que nous expliquaient les philosophes de l’Antiquité se voit confirmé par la science contemporaine, qui étudie le cerveau depuis une trentaine d’années et qui a permis de prouver, notamment avec l’imagerie cérébrale, que les zones du cerveau qui sont activées lorsque l’on est très attentif à ce que l’on fait, dégagent du bien-être par l’activation de substances chimiques comme la sérotonine ou la dopamine. Autrement dit : lorsque l’on est dans l’instant présent, attentif à ce que l’on fait, notre cerveau secrète des substances qui accentuent notre bien-être.
Concrètement ?
FL : Lorsque l’on est présent dans ce que l’on fait : présent dans la relation à l’autre, si on regarde, si on ressent, si on vibre, on sera heureux, parce que cette attention dégage un état de bien-être. A l’inverse, l’une des principales sources du malheur de l’homme contemporain occidental est qu’il fait tellement de choses, et quelquefois en même temps, qu’il a du mal à être attentif à chacune d’elles, ce qui est préjudiciable au bien-être. C’est le cas si on fait quelque chose en pensant à autre chose, si on est soucieux ou si on rumine le passé – ce que l’on fait très souvent.
Votre réflexion par rapport aux philosophes souligne aussi que les anciens étaient beaucoup plus optimistes que les modernes quant à notre capacité au bonheur.
FL : On pourrait dire que le pessimiste est apparu au XIXème siècle, puisque les premiers modernes sont encore optimistes. A l’image de la Renaissance, qui est une époque très optimiste. Montaigne et Spinoza sont très optimistes. Et à partir du XIXème, avec Nietzsche, Schopenhauer et Freud, on découvre un pessimisme qui est global à la pensée intellectuelle européenne sur l’incapacité de l’humain à être heureux, que l’on retrouve à peu près partout. Il s’instaure un scepticisme profond parce que l’on pense que l’être humain est trop soumis à ses désirs et ses passions pour être capable de les dépasser, et par conséquent qu’il ne peut pas vivre un bonheur global. Il y a aussi une sorte d’esthétique du tragique au XIXème, qui est liée au mouvement romantique : les romantiques exaltent le spleen et la souffrance comme quelque chose de créatif, et donc le bonheur n’est pas pour eux une quête intéressante en soi : créer un état de bien-être durable n’est pas le but de leur existence. Tout le courant littéraire et intellectuel du XIXème est imprégné de cette pensée qui accentue ce regard plutôt pessimiste ».
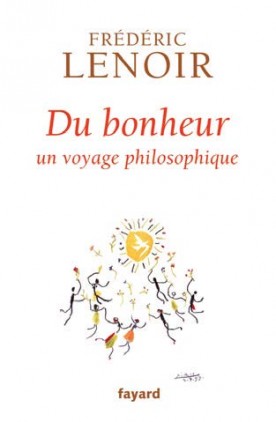 Du bonheur, un voyage philosophique
Du bonheur, un voyage philosophique
220 pages, éd. Fayard,
18 euros.
